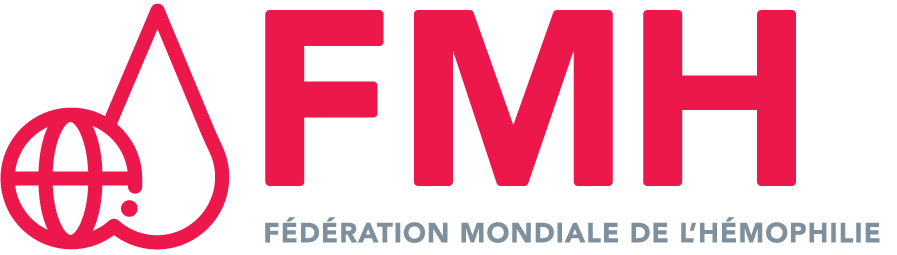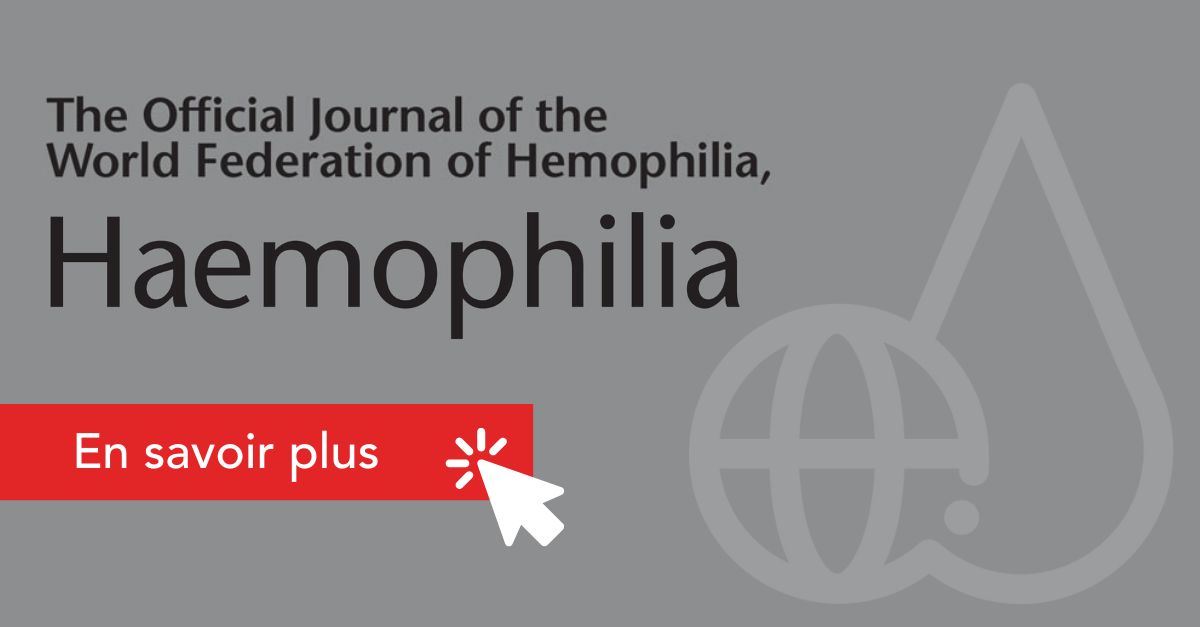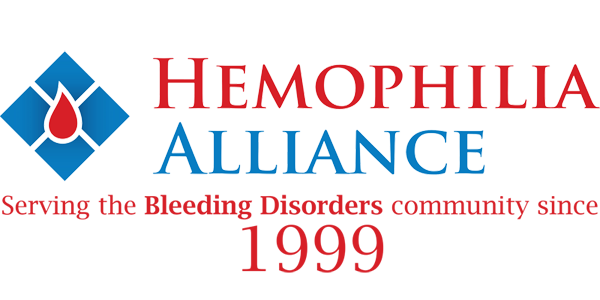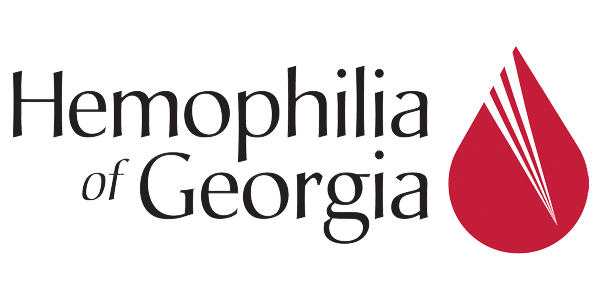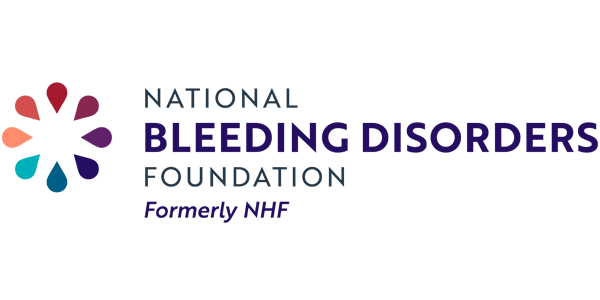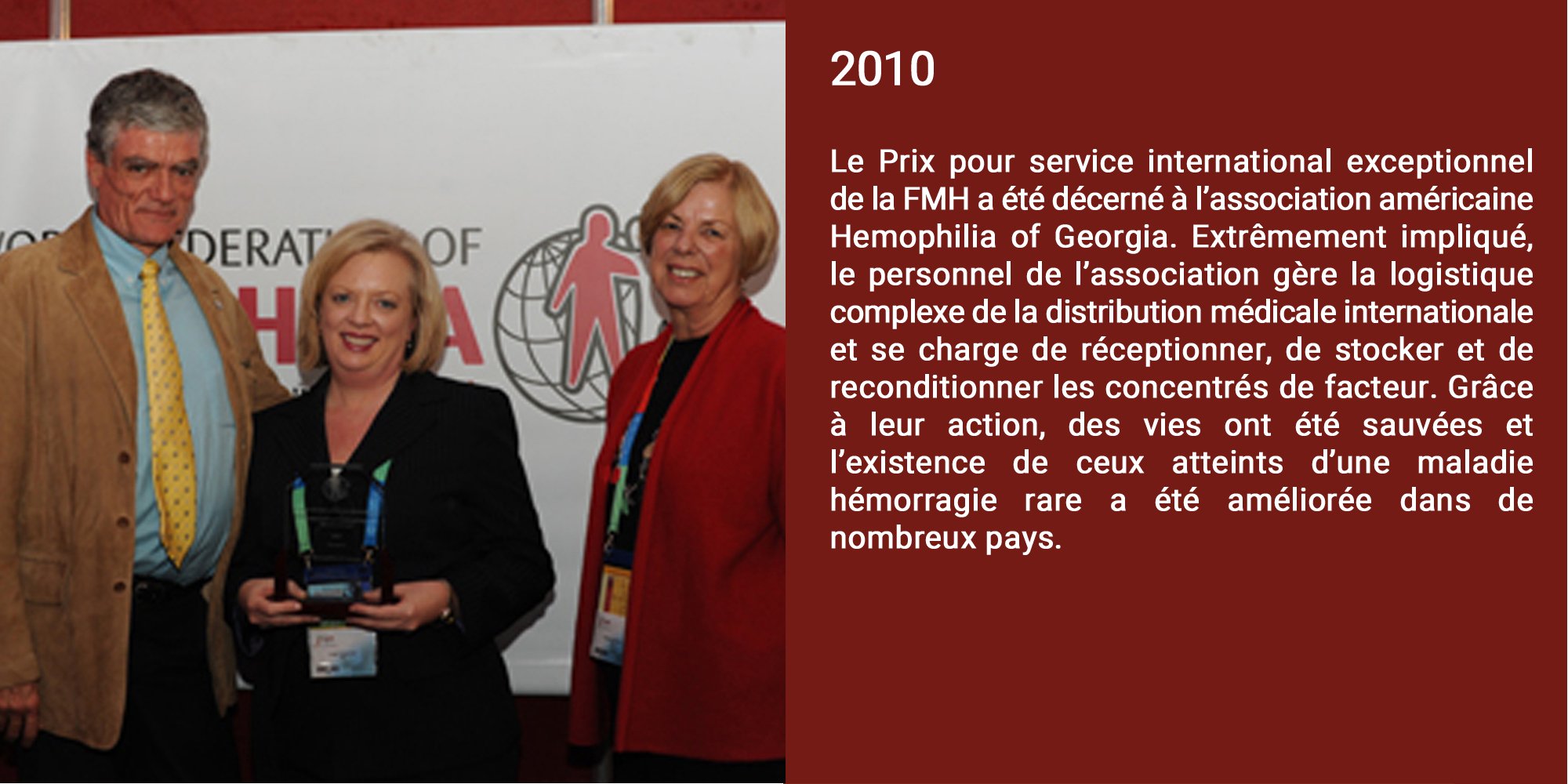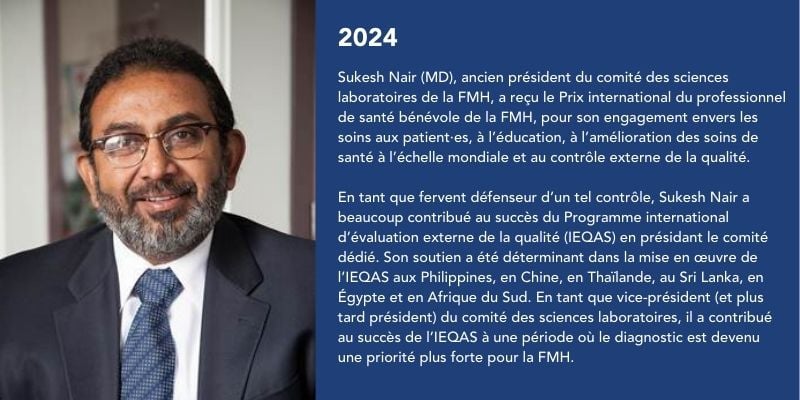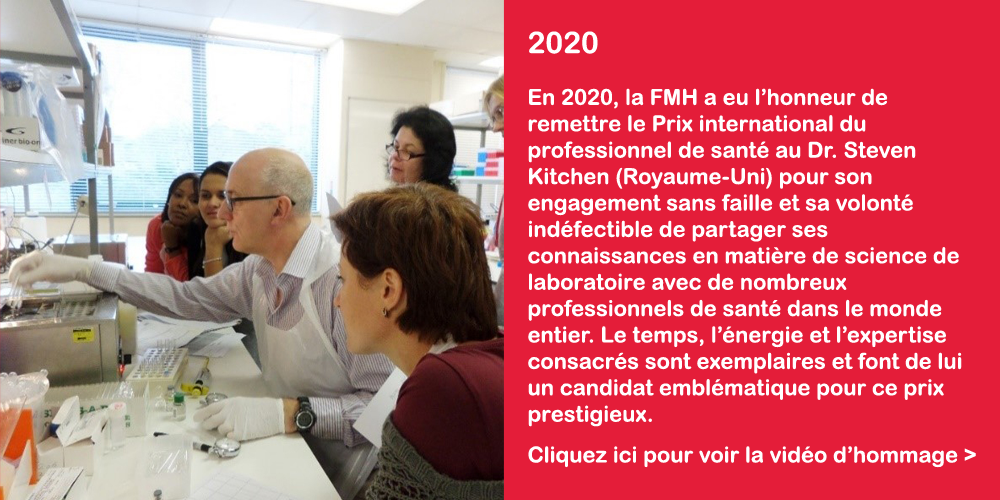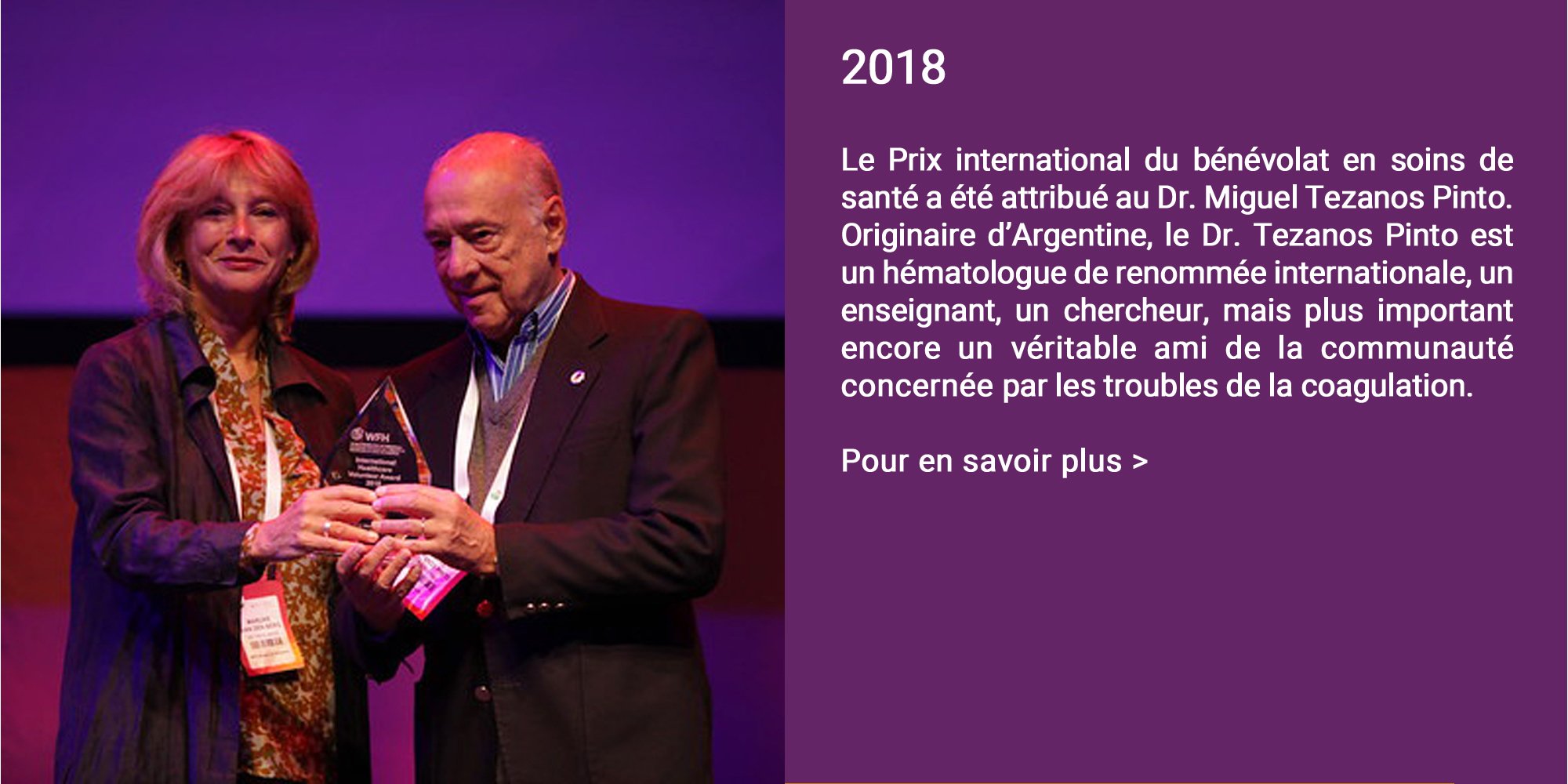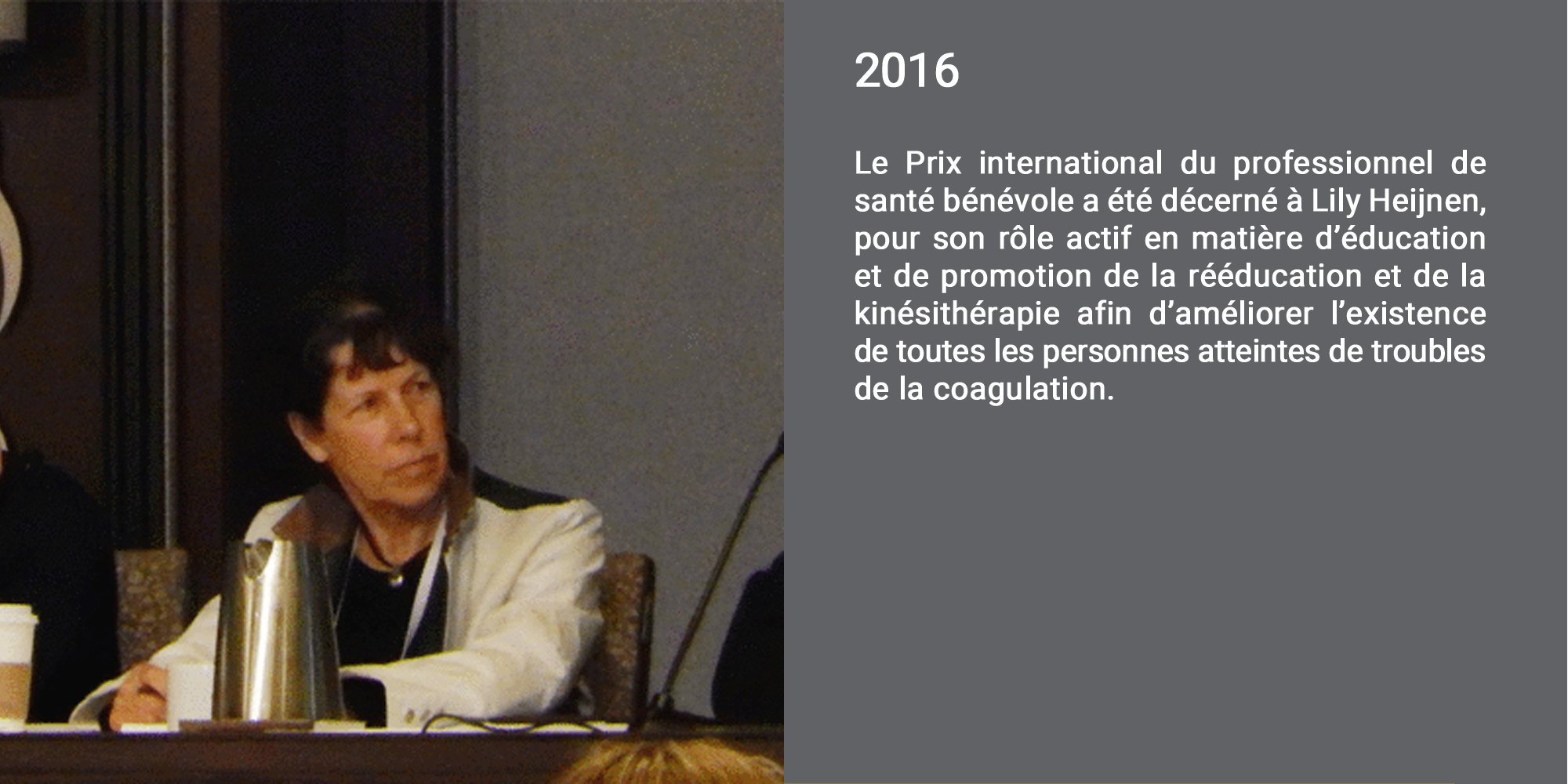Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler avec la FMH et qu’est-ce qui a favorisé la poursuite de votre engagement depuis que vous avez rejoint l’organisation ?
Je suis devenu médecin du travail car j’ai été inspiré par Bernardino Ramazzini, un médecin de la Renaissance qui pensait que la médecine devrait se mettre au service des personnes dans le besoin et pas uniquement des riches. Cette conviction a donné une direction à ma carrière dès le début. Lorsque je pense à l’hémophilie, Bernardino Ramazzini se rappelle à moi : c’est une maladie qui affecte principalement, dans notre monde, les populations vulnérables dans des pays à faibles ressources. C’est une maladie rare dont le traitement est coûteux, et qui est négligée par beaucoup de systèmes de santé. C’est cela qui m’a poussé à travailler avec la FMH : la possibilité de contribuer à rendre les soins durables pour une catégorie de population négligée.
Mon engagement a persisté grâce à l’impact réel et mesurable de mon action. J’ai vu des pays créer des programmes nationaux de soins, des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation avoir accès au traitement, et des systèmes évoluer pour répondre aux besoins de la communauté des troubles de la coagulation. Faire partie d’un mouvement qui change des vies m’inspire au quotidien.
Depuis que vous avez commencé à travailler dans ce domaine, comment ont évolué le traitement et la prise en charge des troubles héréditaires de la coagulation ?
Lorsque j’ai rejoint la FMH en 2000, de nombreux pays se méfiaient encore des concentrés de facteur à cause des scandales du sang contaminé dans les années 1980. Les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation préféraient souvent le cryoprécipité par peur d’autres infections.
Au fil du temps, nous avons contribué à reconstruire une confiance et à établir des protocoles de traitement. Depuis, les soins de l’hémophilie ont progressé rapidement. Les produits à demi-vie prolongée réduisent désormais la fréquence des injections, rendant la prophylaxie plus accessible et plus efficace.
Les thérapies non substitutives comme les anticorps bispécifiques et les agents de rééquilibrage de l’hémostase ont aussi élargi les possibilités de traitement, en particulier pour les personnes présentant des inhibiteurs. Enfin, après des décennies d’attente, la thérapie génique devient enfin réalité.
Aujourd’hui, la prophylaxie est devenue le standard de soins dans la plupart des pays. Les traitements sont plus sûrs, plus efficaces et mieux adaptés aux besoins de chaque individu. On est passé de la gestion de crise à des soins proactifs tout au long de la vie. Beaucoup disent que notre époque est « l’âge d’or » du traitement de l’hémophilie. C’est une évolution remarquable que je suis fier d’avoir pu observer et soutenir.
Pouvez-vous nous raconter quelque chose qui a particulièrement bien marché au cours de votre travail avec la FMH ?
Je peux vous raconter deux histoires qui m’ont beaucoup marqué, l’une au niveau national et l’autre au niveau individuel.
Au niveau national, je peux parler de l’évolution des soins aux troubles héréditaires de la coagulation en Jordanie. La société de l’hémophilie de ce pays est devenue une organisation nationale membre (ONM) de la FMH en 2002. Nous avons travaillé avec elle et avec le ministère de la Santé pour former un comité national. Aujourd’hui, la Jordanie est dotée de plusieurs cliniques, d’un accès solide au traitement, et propose des diagnostics fiables. C’est l’histoire vraie d’un passage d’une quasi-absence de soin à des soins complets. À bien des égards, la Jordanie est un excellent exemple pour les autres ONM.
Au niveau individuel, je peux raconter l’histoire de Megan Adediran, originaire du Nigéria. Elle m’a contacté en 2004. Ses deux fils étaient atteints d’hémophilie et elle avait du mal à leur trouver des soins. Nous avons aidé Megan par l’intermédiaire du Programme d’aide humanitaire de la FMH et l’avons encouragée à utiliser ses compétences naturelles d’initiative pour faire progresser les niveaux de soins au Nigéria. C’est ce qu’elle a fait en fondant la Haemophilia Foundation of Nigeria (HFN), qui est aujourd’hui l’ONM du pays. Elle en est encore à ce jour la directrice exécutive. Au fil des ans, elle a permis de mettre en place 13 centres de traitement et de multiplier par huit les taux de diagnostic au Nigéria. Elle a également été membre profane du conseil d’administration de la FMH. Si la Jordanie est un exemple pour les autres pays, Megan en est un pour les personnes qui veulent aider notre communauté.
Ces deux récits montrent comment la passion individuelle et un soutien structuré peuvent encourager le changement. Ce sont des partenariats de ce type qui donnent vie à la mission de la FMH.
Comment faites-vous coïncider l’aspect commercial de la FMH avec sa vision du Traitement pour tous ?
Lorsque j’ai rejoint la FMH, il y avait des hésitations au sein de l’organisation vis-à-vis d’une collaboration avec le secteur industriel, en particulier avec les compagnies pharmaceutiques. Cela venait en partie d’un manque de confiance hérité des scandales du sang contaminé des années 1980. Je crois cependant qu’il fallait que ces entreprises, qui développent les médicaments dont ont besoin les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation, fassent partie de la solution.
Nous avons aligné notre mission avec le soutien apporté par l’industrie, en construisant des partenariats transparents et efficaces. Nous avons invité nos partenaires commerciaux à être témoins de l’impact véritable de leurs dons, ce qui a renforcé leur engagement. Cela leur a permis de se concevoir non seulement comme des fournisseurs mais aussi comme des partenaires de soins.
Nous avons parallèlement conservé notre neutralité, afin que la FMH reste crédible et indépendante. Traiter tous les partenaires de la même manière est essentiel.
Grâce à cette approche équilibrée, le soutien des entreprises permet désormais de financer le Programme d’aide humanitaire, ainsi que d’autres initiatives pédagogiques au sein de la FMH. Il a aussi permis de renforcer les compétences dans des régions défavorisées. En résumé, il s’agit de favoriser la collaboration et de faire des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation une priorité.
Nous avons prouvé que travailler avec le secteur industriel n’affaiblit pas notre mission mais renforce au contraire notre capacité à l’accomplir.
Quelles compétences ou qualités estimez-vous les plus importantes pour quelqu’un qui travaille dans ce secteur ?
Pour travailler dans ce secteur, le plus important est d’avoir de la détermination. Ce n’est pas un travail quelconque mais une mission humanitaire. Les personnes qui s’épanouissent au sein de la FMH souhaitent sincèrement améliorer la vie des gens.
Une sensibilité aux différentes cultures est également essentielle. La FMH opère dans le monde entier, et le fait de comprendre des histoires, valeurs et traditions diverses permet de construire des partenariats efficaces.
Il faut également être flexible. Les conditions peuvent varier, les projections changent souvent. Il faut savoir s’adapter et trouver des solutions.
De bonnes facultés de communication et de diplomatie sont cruciales. Qu’il s’agisse de traiter avec les médecins, les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation, des ministères ou des donateurs et donatrices, la capacité à créer du lien et à collaborer avec les autres est très importante.
Enfin, la curiosité est un atout. S’informer sur la géographie, la politique et l’histoire permet de s’adapter à des environnements complexes avec respect et perspicacité.
Ce travail est beaucoup plus qu’une somme de compétences techniques : il s’agit de faire preuve d’empathie, de résilience et d’un profond respect pour les communautés que nous servons.
Quel conseil professionnel donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite travailler pour la FMH ?
La FMH propose de vraies opportunités d’évolution. Lorsque je suis arrivé, j’ai commencé comme agent de programme. Au fil du temps, j’ai occupé cinq postes différents pour finir par devenir directeur de l’aide humanitaire et de la formation médicale.
Si vous abordez ce travail avec du cœur et un esprit d’initiative, vous pourrez vous épanouir à la fois professionnellement et personnellement au sein de l’organisation. La FMH encourage l’apprentissage, plusieurs de nos collègues ont obtenu un diplôme universitaire tout en faisant partie de notre équipe. Une personne a même obtenu un master en santé publique en parallèle de son poste à plein temps.
Par-dessus tout, je conseille à toute personne souhaitant travailler à la FMH de se réjouir du fait que son travail aura un impact direct sur la vie des gens, et d’y trouver de la motivation. Si vous êtes guidé par votre détermination et que vous souhaitez toujours en apprendre davantage, la FMH est le bon endroit pour consolider vos compétences, approfondir vos connaissances et contribuer à quelque chose de vraiment utile.
Le Dr Assad E. Haffar (MD) est le directeur de l’aide humanitaire et de la formation médicale au sein de la FMH. Le Programme d’aide humanitaire permet de pallier le manque d’accès aux soins et aux traitements en apportant un soutien indispensable aux organisations nationales membres (ONM), centres de traitement de l’hémophilie (CTH) et aux professionnels de santé dans les pays émergents. Pour en savoir plus sur le Programme, cliquez ici.